Dans un retournement de situation dont l'ironie sautera aux yeux de ceux qui ont connu, au siècle dernier, les débuts difficiles de leurs relations, les partenariats avec les banques semblent désormais devenir la norme pour PayPal. Et celui qu'elle vient juste de conclure avec la britannique Barclays est l'un des plus extensifs à ce jour…
La première partie de cette nouvelle collaboration reste relativement classique, puisqu'elle permettra aux clients particuliers de la banque de connecter facilement et rapidement leurs cartes de débit et de crédit à leur compte PayPal. Double cerise sur le gâteau, les cartes virtuelles arboreront les couleurs de Barclays afin de les identifier instantanément et les informations correspondantes seront automatiquement actualisées lors des renouvellements, à l'arrivée à échéance ou en cas de remplacement anticipé.
À l'inverse, et c'est plus surprenant car les deux solutions paraissent concurrentes, les utilisateurs du porte-monnaie mobile PingIt auront également la possibilité de lui associer leur compte PayPal de manière à étendre les possibilités d'utiliser leur argent en toutes circonstances. Enfin (pour le volet grand public), les clients américains de Barclays auront la possibilité d'utiliser les primes que leur rapportent leur carte de crédit auprès des commerçants acceptant les paiements par PayPal, partout dans le monde.
Le plus important est cependant à rechercher du côté des professionnels. En effet, les commerçants en ligne qui recourent au service de PayPal pour gérer les paiements pourront maintenant intégrer cette partie de leur activité au sein du tableau de bord consolidé de la plate-forme SmartBusiness. Rappelons que cette dernière est conçue pour donner aux responsables d'entreprise une vision à 360° de leurs finances ainsi que des outils de pilotage adaptés. L'ajout de PayPal y est donc particulièrement bienvenu.
Décidément, le statut de la « vieille » startup (elle atteint presque 20 ans !) a bien changé. Elle est aujourd'hui considérée comme un partenaire naturel – et progressivement incontournable – des institutions financières, au même titre que, par exemple, les opérateurs de réseaux Visa et MasterCard. Est-ce une coïncidence si cette nouvelle respectabilité intervient à un moment où une nouvelle génération de solutions de paiement émerge, en s'attaquant directement à ses bastions historiques ?
La première partie de cette nouvelle collaboration reste relativement classique, puisqu'elle permettra aux clients particuliers de la banque de connecter facilement et rapidement leurs cartes de débit et de crédit à leur compte PayPal. Double cerise sur le gâteau, les cartes virtuelles arboreront les couleurs de Barclays afin de les identifier instantanément et les informations correspondantes seront automatiquement actualisées lors des renouvellements, à l'arrivée à échéance ou en cas de remplacement anticipé.
À l'inverse, et c'est plus surprenant car les deux solutions paraissent concurrentes, les utilisateurs du porte-monnaie mobile PingIt auront également la possibilité de lui associer leur compte PayPal de manière à étendre les possibilités d'utiliser leur argent en toutes circonstances. Enfin (pour le volet grand public), les clients américains de Barclays auront la possibilité d'utiliser les primes que leur rapportent leur carte de crédit auprès des commerçants acceptant les paiements par PayPal, partout dans le monde.
Le plus important est cependant à rechercher du côté des professionnels. En effet, les commerçants en ligne qui recourent au service de PayPal pour gérer les paiements pourront maintenant intégrer cette partie de leur activité au sein du tableau de bord consolidé de la plate-forme SmartBusiness. Rappelons que cette dernière est conçue pour donner aux responsables d'entreprise une vision à 360° de leurs finances ainsi que des outils de pilotage adaptés. L'ajout de PayPal y est donc particulièrement bienvenu.
Décidément, le statut de la « vieille » startup (elle atteint presque 20 ans !) a bien changé. Elle est aujourd'hui considérée comme un partenaire naturel – et progressivement incontournable – des institutions financières, au même titre que, par exemple, les opérateurs de réseaux Visa et MasterCard. Est-ce une coïncidence si cette nouvelle respectabilité intervient à un moment où une nouvelle génération de solutions de paiement émerge, en s'attaquant directement à ses bastions historiques ?








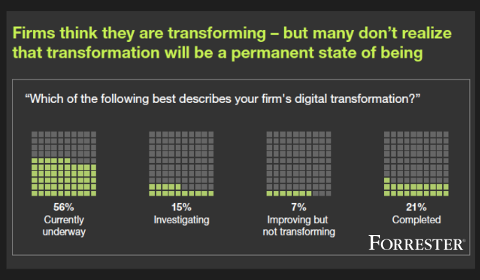








![Communiqué de presse La Parisienne [PDF] La Parisienne](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqdwW05dd12YhhrBDKPdEfTyM5PgdMwd-JqILtNaLmsbiCwonV2gl7Gx60rj7uafuwUFEP9cd3K0xQEMQT43FB06L-iDXk940_3oWzdf0I7hLTMkiBRkWd4S5ww3M0Z1UA7-bYZOFi7bg/s1600/la+parisienne.png)


























