Pendant que les banques centrales des pays développés réfléchissent longuement à l'opportunité d'émettre des monnaies électroniques (la dernière en date en Corée), il se pourrait que la première à être émise soit sénégalaise. C'est en tous cas l'objet de l'accord que viennent de conclure la startup eCurrency et la Banque Régionale de Marchés.
En conformité avec la réglementation de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) relative aux e-monnaies, l'e-CFA – dont la valeur est équivalente à sa contrepartie « physique » – pourra ainsi être intégré légalement dans les plates-formes de paiement électroniques, avec les garanties de sécurité, d'interopérabilité et de liquidité que les citoyens attendent de leur devise nationale, tout en leur garantissant le même anonymat que lorsqu'ils règlent leurs achats avec des pièces et billets. Le déploiement initial, au Sénégal, devrait rapidement être étendu à l'ensemble de l'UEMOA.
Loin des mythes qui agitent tellement d'acteurs aujourd'hui, il n'est pas question ici de technologies de blockchain ou de livre de compte distribué. Car la seule ambition d'eCurrency est de permettre aux banques centrales de continuer à jouer pleinement leur rôle d'émission et de contrôle de leur devise, quelle que soit la forme qu'elle revêt. Sa solution consiste donc en une sorte d'atelier centralisé d'émission de monnaie virtuelle infalsifiable et nativement adaptée aux échanges sur les réseaux informatiques.
Naturellement, une telle approche paraîtra relativement peu innovante. Toutefois, il ne faut pas se tromper : comme leur nom le rappelle, les banques centrales n'ont que faire pour remplir leur mission – bien au contraire ! – de la décentralisation qui est au cœur du concept de blockchain (et des mécanismes de calcul distribué qui la rendent possible). Inutile dans ces conditions de s'égarer avec des idées à la mode, les défis de conception d'un équivalent électronique du cash sont déjà suffisamment difficiles à relever.
En conformité avec la réglementation de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) relative aux e-monnaies, l'e-CFA – dont la valeur est équivalente à sa contrepartie « physique » – pourra ainsi être intégré légalement dans les plates-formes de paiement électroniques, avec les garanties de sécurité, d'interopérabilité et de liquidité que les citoyens attendent de leur devise nationale, tout en leur garantissant le même anonymat que lorsqu'ils règlent leurs achats avec des pièces et billets. Le déploiement initial, au Sénégal, devrait rapidement être étendu à l'ensemble de l'UEMOA.
Loin des mythes qui agitent tellement d'acteurs aujourd'hui, il n'est pas question ici de technologies de blockchain ou de livre de compte distribué. Car la seule ambition d'eCurrency est de permettre aux banques centrales de continuer à jouer pleinement leur rôle d'émission et de contrôle de leur devise, quelle que soit la forme qu'elle revêt. Sa solution consiste donc en une sorte d'atelier centralisé d'émission de monnaie virtuelle infalsifiable et nativement adaptée aux échanges sur les réseaux informatiques.
Naturellement, une telle approche paraîtra relativement peu innovante. Toutefois, il ne faut pas se tromper : comme leur nom le rappelle, les banques centrales n'ont que faire pour remplir leur mission – bien au contraire ! – de la décentralisation qui est au cœur du concept de blockchain (et des mécanismes de calcul distribué qui la rendent possible). Inutile dans ces conditions de s'égarer avec des idées à la mode, les défis de conception d'un équivalent électronique du cash sont déjà suffisamment difficiles à relever.
En réalité, l'e-CFA représente tout de même bien une révolution, en étant l'une des premières (voire la première ?) véritables e-monnaies d'état. Il n'est d'ailleurs pas surprenant qu'elle naisse dans une région où les outils numériques (téléphone mobile en tête) se développent à une vitesse extraordinaire, tandis que les échanges économiques sont fortement handicapés par un taux de bancarisation de la population inférieur à 20%. L'enjeu est, tout simplement, d'accélérer l'inclusion financière selon un modèle adapté au XXIème siècle et non basé sur des instruments d'une autre époque.
À l'inverse, là réside l'obstacle principal auquel sont confrontés nos marchés « avancés » : les moyens mis à notre disposition par nos banques ont supporté, bon an mal an, la transition vers l'ère « digitale » et constituent de la sorte une bonne excuse pour ne pas chercher à changer les fondations de la gestion de la monnaie. Pourtant, les frictions présentes aux frontières entre les mondes physique et électronique vont devenir de plus en plus insupportables et il faudra bien un jour basculer sur une autre vision…
À l'inverse, là réside l'obstacle principal auquel sont confrontés nos marchés « avancés » : les moyens mis à notre disposition par nos banques ont supporté, bon an mal an, la transition vers l'ère « digitale » et constituent de la sorte une bonne excuse pour ne pas chercher à changer les fondations de la gestion de la monnaie. Pourtant, les frictions présentes aux frontières entre les mondes physique et électronique vont devenir de plus en plus insupportables et il faudra bien un jour basculer sur une autre vision…



![Communiqué de presse Banque de France [PDF] Banque de France](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgX8WeK8R9Sqw7PJY3MofTD5aRRUFBLR8aSas1aHwsDB8ploa-CwCxg2le94c14ADSPutnizG2LJLwUG9by82Fllq7i3ZI7O0mJLnQWNXmG_cgIm3RTUirsjt-5biRu_3dB7VsQu3zapQ/s1600/banque+de+france.png)
![Communiqué de presse Banque de France [PDF] Annonce de l'Open Data Room](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj01M_OjaHBTPXYDi9aDpXoe7bwrpqfkgRtQGNor1i7e0hvah_t_mosUMla601dKqKTnwCUgw5JFhCN4gPxM9RtliMCFGp6iY0mA10H98kYArcVUVZEvo2wi9GGBok9kJEkeoLlMwV24sE/s1600/open+data+room.png)









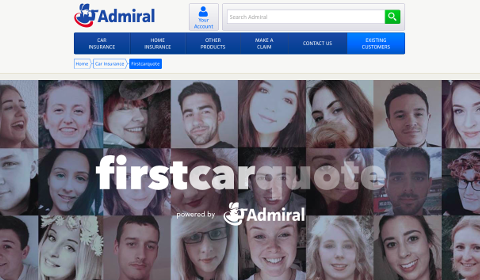

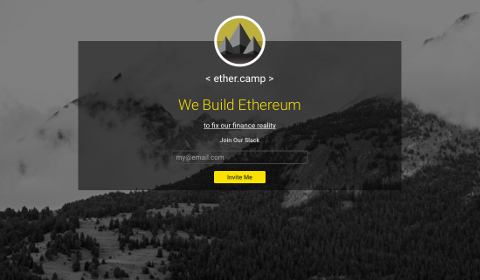


![Communiqué de presse N26 [PDF] N26](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifAKpn3ZPm_sVyMHKtxnYUTZOWg4lrnj914XMJb4And2yEXDNINHW1za-8gEMxJ8b-uPG1E6y_A0aTP9KdJqFHiTuruGE9gzB4j7-_H-u55BbUXtjl4ypbArgOAGaFwLmnKsq81mjnXgQ/s1600/n26.png)
