La révélation par Bloomberg d'un accord secret de commercialisation d'informations de paiement entre Mastercard et Google semble en bonne voie de déclencher un nouveau scandale sur les excès de l'exploitation des données personnelles. Pourtant, quand Google annonçait sa démarche, en mai 2017, nul ne s'en inquiétait…
Résumons. Depuis plus d'un an, donc, le géant de la publicité sur le web expérimente une nouvelle technique destinée à donner aux annonceurs une mesure plus précise de l'efficacité de leurs campagnes en ligne sur leurs ventes en magasin. L'enjeu est colossal, car il lui permet de démontrer concrètement la valeur de ses solutions marketing et incite les entreprises à accroître leurs budgets, au profit du chiffre d'affaires de Google, qui ne cesse de progresser malgré une impression de saturation du marché.
Pour cela, ses redoutables algorithmes combinent sa connaissance intime des internautes (qui cliquent sur les résultats de recherche sponsorisés), la détection de leur présence dans les boutiques de ses clients (grâce à Google Maps installé sur leur téléphone)… et les caractéristiques des transactions de paiement que lui fournissent ses partenaires (couvrant 70% des cartes en circulation aux États-Unis) – on peut supposer que le lieu et l'heure, a minima, procurent déjà de solides bases de rapprochement.
Par rapport à cette présentation succincte du service, la seule information inédite qu'apporte Bloomberg est la participation de Mastercard. Même si j'avais, à l'époque, plutôt imaginé que les données étaient transmises par des émetteurs de cartes, il n'y a pas vraiment là de quoi être très surpris. Alors pourquoi cette offre « Attribution » de Google suscite-t-elle autant d'émoi aujourd'hui ? Probablement parce que la sensibilité du grand public à l'usage de ses données a été exacerbée par les affaires récentes.
Il suffit alors – comme ce fut le cas avec le fiasco ING en 2014 – de monter l'initiative en épingle pour qu'elle soit rapidement perçue comme un abus de pouvoir. Les acteurs en cause ont beau arguer des précautions (crédibles, à mon avis) qu'ils déploient pour garantir la protection de la vie privée des consommateurs, via anonymisation et chiffrement des données mises en œuvre, le mal est fait. Et, encore une fois, le manque de transparence de Mastercard peut justifier, partiellement, au moins, l'indignation.
Le résultat prévisible de cette « affaire » (si elle ne s'éteint pas d'elle-même) sera, comme toujours, un coup d'arrêt sur les projets des institutions financières. Idéalement, ce pourrait surtout être une occasion pour elles de s'interroger sur la nature de leurs ambitions : quand elles peuvent démontrer, clairement, sans ambiguïté et en toute transparence, qu'elles utilisent les données de leurs clients à leur avantage, pour leur offrir un meilleur service, elles ne devraient pas craindre de retombées négatives.
Résumons. Depuis plus d'un an, donc, le géant de la publicité sur le web expérimente une nouvelle technique destinée à donner aux annonceurs une mesure plus précise de l'efficacité de leurs campagnes en ligne sur leurs ventes en magasin. L'enjeu est colossal, car il lui permet de démontrer concrètement la valeur de ses solutions marketing et incite les entreprises à accroître leurs budgets, au profit du chiffre d'affaires de Google, qui ne cesse de progresser malgré une impression de saturation du marché.
Pour cela, ses redoutables algorithmes combinent sa connaissance intime des internautes (qui cliquent sur les résultats de recherche sponsorisés), la détection de leur présence dans les boutiques de ses clients (grâce à Google Maps installé sur leur téléphone)… et les caractéristiques des transactions de paiement que lui fournissent ses partenaires (couvrant 70% des cartes en circulation aux États-Unis) – on peut supposer que le lieu et l'heure, a minima, procurent déjà de solides bases de rapprochement.
Par rapport à cette présentation succincte du service, la seule information inédite qu'apporte Bloomberg est la participation de Mastercard. Même si j'avais, à l'époque, plutôt imaginé que les données étaient transmises par des émetteurs de cartes, il n'y a pas vraiment là de quoi être très surpris. Alors pourquoi cette offre « Attribution » de Google suscite-t-elle autant d'émoi aujourd'hui ? Probablement parce que la sensibilité du grand public à l'usage de ses données a été exacerbée par les affaires récentes.
Il suffit alors – comme ce fut le cas avec le fiasco ING en 2014 – de monter l'initiative en épingle pour qu'elle soit rapidement perçue comme un abus de pouvoir. Les acteurs en cause ont beau arguer des précautions (crédibles, à mon avis) qu'ils déploient pour garantir la protection de la vie privée des consommateurs, via anonymisation et chiffrement des données mises en œuvre, le mal est fait. Et, encore une fois, le manque de transparence de Mastercard peut justifier, partiellement, au moins, l'indignation.
Le résultat prévisible de cette « affaire » (si elle ne s'éteint pas d'elle-même) sera, comme toujours, un coup d'arrêt sur les projets des institutions financières. Idéalement, ce pourrait surtout être une occasion pour elles de s'interroger sur la nature de leurs ambitions : quand elles peuvent démontrer, clairement, sans ambiguïté et en toute transparence, qu'elles utilisent les données de leurs clients à leur avantage, pour leur offrir un meilleur service, elles ne devraient pas craindre de retombées négatives.





![Communiqué de presse Equity Group Holdings [PDF] Finserve](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpKVQO8KDKXeghsXVqGFz3vL2QT2WqpNiHp2fnIogEl-7Z5SZONWYL7mzLJTWlxittMzJpPosddXzlTTudnsRQ6-1NR10rzbrCZsqR7EYPxRWOFDVrMAQz0Sh7TpJwssiE7uI3n66YYyQ/s1600/finserve.png)
![Communiqué de presse Equity Group Holdings [PDF] Equity Group Holdings](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZKebGY8pjw_0J-UI37M1gJqeB7uqal2KnH_inpUvhzqhMs5mwiLpqUjYiyndWbftSh7Ck681zYetNPO_ePjo4yG36RscTeObtGSZh7v_1nwiQT51ZNEw3ZR-u1VhuE2FCERq_IlbqN-8/s1600/equity+group.png)





















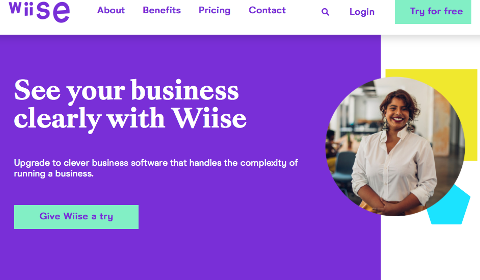



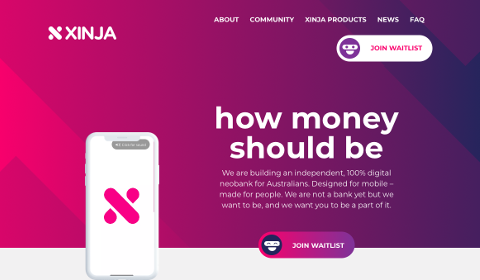


![Communiqué de presse IBF Singapour [PDF] IBF Singapour](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixpPNFYghT1IUhX3NgFPg8leWnMDm_H9DeuFp03JBzWi4spdbh1iLiGG33mA49BMS9dkVAturprG2pzrio4dlUT4ucxfSE15zp0mxgbdd6gsux29P_H5orx_GEz0UvE6JQUoDfYz3SGA0/s1600/ibf.png)
![Communiqué de presse IBF Singapour [PDF] IBF Careers Connect](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzSUxjdOadLqJF9_PTmTk79tVqajDqUI1p3H00dLucVtVR7ce2_Q905kdj0_O9qno3CbvcAN-BDqgMG2bUfEnF3pcHt_oFbEYrdwVEEOmURWz5xeEHOiiqs2Rm14ocLBG57attsk6_XzE/s1600/ibf+careers+connect.png)





